La PrEP et ses effets secondaires : à quoi s’attendre lorsqu’on prend du Truvada ?

En sa qualité de médicament, la PrEP a des effets secondaires. Si elle permet de se protéger contre une infection par le VIH, il est toutefois important de connaître ses effets indésirables et ses contre-indications. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.
La PrEP, c’est quoi ?
La PrEP signifie Prophylaxie Pré-Exposition. C’est donc un traitement préventif ayant pour but d’empêcher une infection par le VIH, virus d’immunodéficience humaine. Il s’agit d’une infection sexuellement transmissible qui a de lourdes conséquences sur la santé. Lorsque le virus s’installe dans l’organisme, il ne vous quitte plus ; une guérison n’est pas possible.
Souvent silencieux, le virus s’attaque à votre système immunitaire durant des années jusqu’à ce que celui-ci soit totalement impuissant. C’est alors qu’arrive la phase finale de l’infection : le sida, syndrome d’immunodéficience acquise. Le corps est alors sujet à des maladies opportunistes et graves qui finissent par provoquer la mort du patient.
Ainsi, le traitement PrEP est une révolution dans la prévention contre ce virus. Il permet aux personnes séronégatives de le rester, même en cas de contact avec le VIH. En France, la PrEP est commercialisée sous le nom de Truvada (il existe toutefois 5 génériques). Elle est composée de deux molécules anti-VIH, l’Emtricitabine et le Ténofovir disoproxil.
Besoin de l'avis d'un médecin sexologue ?
- Réservez votre rdv avec un médecin sexologue en moins de 24h et 7j/7 👨⚕️
- Téléconsultez par téléphone, visio ou messages instantanés 📱
- Seulement 35€ la consultation (au lieu de 80€ en moyenne en cabinet) 💸
- Obtenez une ordonnance pour votre traitement en cas de besoin 📝
- Faites-vous livrer via des pharmacies partenaires chez vous sous 48h et en toute discrétion 📦
Qui peut accéder à la PrEP ?
Globalement, la prescription de la PrEP s’adresse aux populations à haut risque de contraction du virus, c’est-à-dire les personnes qui sont les plus exposées au VIH.
- Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;
- personnes transgenres ;
- travailleurs et travailleuses du sexe ;
- personnes multipartenaires ;
- consommateurs de drogues en intraveineuse, notamment avec partage de seringue, etc.
Toutefois, la prescription de la PrEP se fait au cas par cas, en fonction du risque encouru dans votre situation personnelle. C’est d’ailleurs ce qu'il va falloir évaluer lors de la première consultation avec le médecin prescripteur.
Ainsi, pour se faire prescrire la PrEP, il est possible de consulter n’importe quel médecin : médecin hospitalier, médecin généraliste, médecin de CeGIDD, etc. Cela n’a pas toujours été le cas, mais les autorités de santé ont souhaité faciliter le parcours d’accès à ce traitement.
Une première consultation permet au médecin de comprendre votre situation et d’évaluer à quel point vous êtes susceptible de rencontrer le virus. Il vous prescrit également un test IST complet et une sérologie VIH. Lors de la deuxième consultation, lorsque le test IST revient négatif et que la sérologie HIV1 et HIV2 est négative également, il prescrit la PrEP pour 1 mois. Une troisième consultation permet de faire un premier bilan puis, s’il n’y a rien à signaler, le médecin renouvelle le traitement pour 3 mois.
Vous avez ensuite un suivi médical rigoureux tous les 3 mois : dépistage VIH, hépatites et IST, bilan rénal,...
Comment prendre le traitement PrEP ?
Il existe deux modes d’administration pour la PrEP :
- La PrEP en continu : l’idée est de prendre un comprimé tous les jours à heure fixe. Le patient bénéficie alors d'une protection sans interruption. Toutefois, la protection n’est optimale qu’après le 7ème jour de traitement.
- La PrEP à la demande : l’idée est de ne prendre le traitement qu’en période d’activité sexuelle. Le patient n’est alors protégé que lorsqu’il applique le schéma : deux comprimés 24 à 2 heures avant le rapport sexuel, puis un comprimé le lendemain et un comprimé le surlendemain, toujours à heure fixe.
Par ailleurs, la PrEP est un traitement très efficace. Les études montrent l’absence de contamination lorsque celui-ci est pris correctement. En effet, la PrEP ne peut pas avoir une efficacité optimale en cas d’oubli ou de retard de prise. Une marge de plus ou moins deux heures est tolérée, mais une heure fixe est l’idéal.
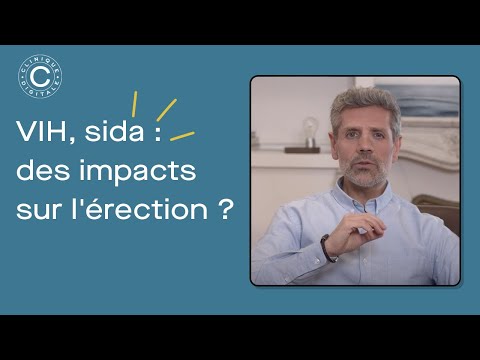
Besoin de l'avis d'un médecin sexologue ?
- Réservez votre rdv avec un médecin sexologue en moins de 24h et 7j/7 👨⚕️
- Téléconsultez par téléphone, visio ou messages instantanés 📱
- Seulement 35€ la consultation (au lieu de 80€ en moyenne en cabinet) 💸
- Obtenez une ordonnance pour votre traitement en cas de besoin 📝
- Faites-vous livrer via des pharmacies partenaires chez vous sous 48h et en toute discrétion 📦
Quels sont les effets secondaires de la PrEP ?
Généralement, les patients tolèrent bien le traitement PrEP. Toutefois, comme pour tout médicament, vous pouvez parfois ressentir quelques effets indésirables, notamment au début du traitement. Ceux-ci doivent être légers et disparaître spontanément en quelques jours. Toutefois, s’ils persistent, consultez votre médecin. De même, n’hésitez pas à les mentionner lors de vos RDV trimestriels avec le médecin qui vous a prescrit le traitement.
- Effets secondaires de la PrEP très fréquents (> 1 personne sur 10) : nausées, vomissements, diarrhées, maux de tête, vertiges, éruption cutanée, fatigue.
- Effets secondaires fréquents (jusqu'à 1 personne sur 10) : insomnie, rêves anormaux, digestion difficile, douleur abdominale, ballonnements, démangeaisons, urticaire.
Dans des cas plus exceptionnels, il peut y avoir des effets secondaires un peu plus préoccupants comme la pancréatite. Il convient alors de consulter votre médecin dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le risque d’insuffisance rénal existe et il justifie le bilan rénal régulier dans le cadre du suivi médical.
- Effets secondaires peu fréquents (jusqu'à 1 personne sur 100) : pancréatite, œdème de Quincke, faiblesse musculaire.
- Effets secondaires rares : acidose lactique (le risque est très faible, mais il est accru en cas d'association avec un médicament contenant de la didanosine), insuffisance rénale.
De plus, notez qu’au cours du traitement, on peut observer certaines variations sur les résultats de vos analyses sanguines. On remarque notamment une augmentation des transaminases et de la bilirubine, une élévation de la créatine phosphokinase (CPK) ou une baisse du nombre de globules blancs.
Enfin, la prise d’un traitement antirétroviral comme la PrEP peut entraîner une prise de poids ainsi qu’une augmentation des graisses et du taux de glucose dans le sang.
PrEP effets secondaires : quelles sont les contre-indications ?
La PrEP est contre-indiquée aux personnes infectées par le VHB, le virus de l’hépatite B. C’est pourquoi il est important de dépister cette infection virale régulièrement tout au long du traitement.
Il existe aussi des interactions médicamenteuses. En effet, les médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie orale (type Ibuprofène ou Voltarène) peuvent être toxiques pour les reins lors d’un traitement PrEP. Il convient donc de les éviter.
De même, la prise de produits comme le psyllium, le charbon actif ou les pansements gastriques sont à éviter. En effet, ils peuvent empêcher la bonne assimilation des molécules s’ils sont consommés deux heures avant ou deux heures après la prise du médicament.
Bon à savoir : l’Emtricitabine et le Ténofovir disoproxil, les deux molécules de la PrEP, n’ont pas d’interaction connue avec l’alcool, les drogues récréatives, les antidépresseurs ou les traitements contraceptifs (pilule contraceptive par exemple). Il ne semble pas non plus y avoir d’effets connus sur la sexualité : pas de baisse de libido, pas de problème d’érection, pas d'impuissance chez l'homme ni d’éjaculation précoce ou d’éjaculation tardive.
Enfin, sachez qu’il est important de connaître votre sérologie quant au VIH. C’est pourquoi il faut réaliser régulièrement un dépistage du virus du sida lorsque vous êtes sous PrEP. En effet, votre médecin a besoin de savoir s’il y a une séroconversion pendant le traitement, car cela peut provoquer des mutations de résistance au VIH. Le traitement à prendre ensuite pour freiner l’évolution de l’infection (la trithérapie) en sera moins efficace.
Besoin de l'avis d'un médecin sexologue ?
- Réservez votre rdv avec un médecin sexologue en moins de 24h et 7j/7 👨⚕️
- Téléconsultez par téléphone, visio ou messages instantanés 📱
- Seulement 35€ la consultation (au lieu de 80€ en moyenne en cabinet) 💸
- Obtenez une ordonnance pour votre traitement en cas de besoin 📝
- Faites-vous livrer via des pharmacies partenaires chez vous sous 48h et en toute discrétion 📦

PrEP et effets secondaires : que se passe-t-il si j’arrête le traitement ?
Tout d’abord, rappelons que les spécialistes déconseillent d’arrêter le traitement seul. Parlez-en avec votre médecin avant de prendre votre décision.
Parfois, un effet secondaire peut être si gênant pour vous qu’il vous pousse à arrêter le traitement. Une fois celui-ci stoppé, c’est-à-dire dès le premier comprimé non pris, il faut considérer que vous n’êtes plus protégé. Vous ne pouvez plus compter sur la PrEP pour éviter une infection par le VIH. Les rapports sexuels non protégés sont donc à prohiber après l’arrêt du traitement !
Il faut alors vous en remettre aux autres solutions de prévention. Tout d’abord, le port du préservatif, bien connu de tous, vous protège d’une infection. Il est efficace lorsque vous l'utilisez du début à la fin du rapport sexuel, lors des pénétrations vaginales, pénétrations anales, fellations et cunnilingus.
Ensuite, il est très important de poursuivre le dépistage régulier du VIH.
Le dépistage du VIH
Quelle que soit votre situation, les professionnels recommandent vivement le dépistage du VIH. Pour les personnes fortement exposées au virus (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes par exemple), le bilan sanguin VIH doit être fait tous les 3 mois. Pour les autres, cela peut être après un rapport sexuel non protégé, lorsque vous avez un nouveau partenaire ou si vous avez le moindre symptôme évocateur de la maladie.
Le dépistage peut se faire en laboratoire d’analyses médicales, sur ordonnance pour bénéficier d’un remboursement. Il faut alors réaliser une prise de sang pour réaliser le test ELISA. Ce test est fiable 6 semaines après la dernière exposition au virus.
Un TROD, Test Rapide d’Orientation Diagnostique, permet aussi de dépister efficacement le VIH. Il peut se faire gratuitement dans les CeGIDD ou les associations de lutte contre le sida. Il permet d’avoir un résultat en 15 minutes, fiable si la dernière prise de risque remonte à plus de 3 mois.
Enfin, les TROD se déclinent aussi en autotests VIH. Disponibles en libre accès en pharmacie, ils permettent d’effectuer un auto-dépistage à domicile. C’est en effet vous-même qui prélevez une goutte de sang au bout de votre doigt (avec un auto-piqueur) et qui la déposez sur le test. Résultat fiable en 15 minutes si vous n’avez pas été en contact avec le virus dans les 3 derniers mois. Ces tests VIH en pharmacie sont très pratiques et facilitent le dépistage, notamment chez les personnes un peu honteuses de se rendre dans une structure dédiée. Toutefois, il faut veiller à l’effectuer correctement pour qu’il soit fiable ; suivez scrupuleusement la notice d’utilisation.
Besoin de l'avis d'un médecin sexologue ?
- Réservez votre rdv avec un médecin sexologue en moins de 24h et 7j/7 👨⚕️
- Téléconsultez par téléphone, visio ou messages instantanés 📱
- Seulement 35€ la consultation (au lieu de 80€ en moyenne en cabinet) 💸
- Obtenez une ordonnance pour votre traitement en cas de besoin 📝
- Faites-vous livrer via des pharmacies partenaires chez vous sous 48h et en toute discrétion 📦
À voir aussi

Les boutons sur le pénis sont une source d’inquiétude pour de nombreux hommes. Bien que souvent bénins, ils peuvent parfois révéler une affection sous-jacente. Cet article vous aide à comprendre leur origine, comment les traiter et les prévenir.

Le terme exact pour parler d’une mycose du pénis (mycose génitale masculine) est balanite. Cette affection est souvent due à un champignon, le Candida Albicans, et se localise plutôt sur les muqueuses comme le gland du pénis. Alors, quels sont les symptômes, causes et traitements de cette affection ? On vous explique tout.


